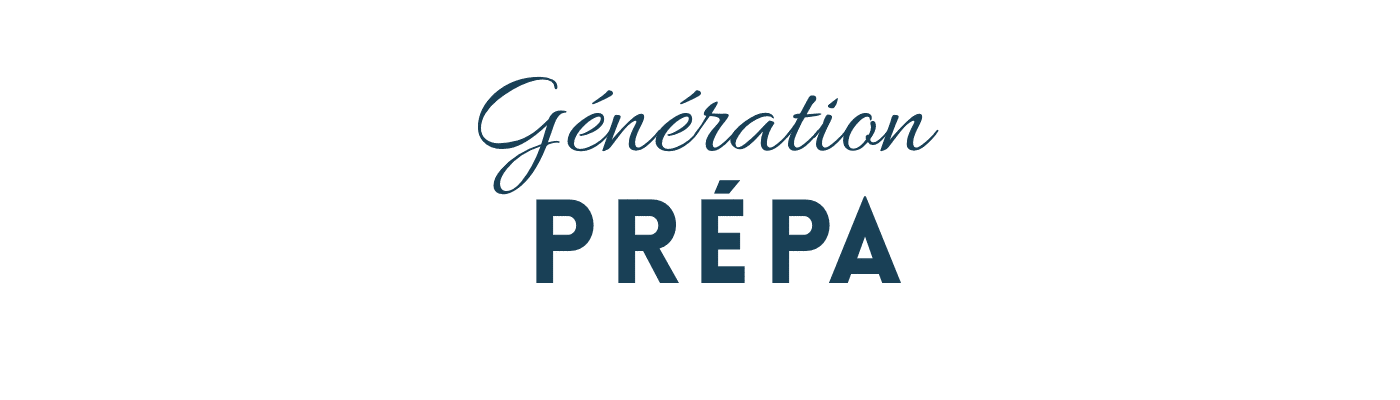Il a choisi de démissionner de CentraleSupélec, ses explications !
Dans un acte de courage et de conviction, James Amar, un ex-étudiant de CentraleSupélec a récemment démissionné de son cursus d’ingénieur pour exprimer des préoccupations profondes concernant notre planète et notre société. Dans cette interview, il partage son parcours académique, ses prises de conscience environnementales et sociales, ainsi que ses réflexions sur le rôle des ingénieurs dans un monde en pleine transition. Sa démarche nous invite à repenser notre système éducatif, à explorer de nouvelles voies pour un avenir durable, et à remettre en question notre rapport à l’économie et à la préservation de la vie sur Terre.
Pourriez-vous nous parler de votre propre parcours académique et professionnel jusqu’à présent, et expliquer comment vous en êtes venu à prendre conscience des questions environnementales et sociales que vous abordez dans votre lettre de démission? Quels événements ou expériences ont contribué à façonner vos convictions actuelles ?
J’ai toujours été un très bon élève. Après avoir obtenu mon bac S au lycée Janson de Sailly en 2019, je me suis orienté vers une classe préparatoire MPSI, parce que j’adorais les maths (d’ailleurs j’adore toujours les maths). Au départ, je rêvais de faire une ENS. Je suis donc passé par le lycée Louis-le-Grand où j’ai passé deux ans de prépa très stimulants, mais épuisants vers la fin du parcours. A l’issue des concours, la meilleure école que j’ai eue était CentraleSupélec, et bien que je n’étais pas particulièrement convaincu de quitter Paris pour aller dans un endroit aussi reculé que Gif-sur-Yvette, je me suis laissé séduire par le discours donné par cette école qui prétend ouvrir « toutes les portes » et aussi par la présence d’une forte vie associative dans laquelle je voulais m’épanouir après ma vie de taupe. Et puis, honnêtement, dans la tête de tout le monde (y compris la mienne à l’époque), CentraleSupélec, ça ne se refuse pas. La stabilité de l’emploi, l’argent, le prestige ou l’honneur sont des idées qui rassurent sur le fait que choisir CentraleSupélec (ou n’importe quelle grande école) est un « bon choix ». Bref, je ne suis pas allé à contre-courant de l’imaginaire collectif et j’ai choisi d’aller à CS.
Quant aux prises de conscience, elles sont arrivées bien sûr très progressivement. Au lycée, je ne participais pas aux mouvements comme Fridays for future mais j’ai été sensible aux messages que les marches pour le climat portaient. C’est vers ce moment-là que j’ai su que la priorité absolue, c’était la lutte contre le dérèglement climatique. Je n’étais pas attiré par la politique et je n’ai pas vraiment eu le temps de l’être en prépa, où mes sources d’informations étaient quelques lectures sporadiques de magazines chez mes parents ou en ligne. De toute façon, en prépa scientifique, se politiser n’était pas vraiment un enjeu central. Puis c’est à l’entrée en école que j’ai commencé à me poser beaucoup de questions, passée la période des soirées intempestives, agréables mais étourdissantes. Je me souviens d’une conférence de Julia Faure, co-fondatrice de Loom (une marque de vêtements éthiques). Elle intervenait dans le cadre d’un cours mené par une professeure qui remettait beaucoup notre système économique en question. C’est la première fois que j’ai entendu : « Vous croyez peut-être que la science et la technique peuvent nous sortir d’affaire. Mais on l’a vu, et on continue de le voir : ça ne marche pas. » (Je cite de mémoire.) J’ai été choqué et un peu désemparé, moi qui croyais qu’éventuellement en tant qu’ingénieur j’allais pouvoir apporter quelque chose en matière d’écologie ! Puis, de fil en aiguille, je me suis informé, j’ai commencé à ouvrir les yeux sur ce qu’était vraiment « la croissance verte » (c’est-à-dire une belle arnaque) et autres « solutions » que le système classique mettait en avant. Des discussions avec des connaissances ou ami·e·s m’ont mis au courant et donné envie de creuser davantage des sujets sociaux auxquels je n’étais pas vraiment sensibilisé.
Je dirais donc que mes convictions actuelles ont été façonnées par différentes sources : d’abord, la science, et plus précisément tous les scientifiques qui nous alertent depuis des années sur notre inaction ou sur la cruelle inefficacité de nos « actions ». Je pense au dernier rapport du GIEC qui a été comme un coup de massue. Et puis mon quotidien : j’évoluais au milieu de représentants de grandes entreprises et dans une école « d’élite », je voyais donc directement ce à quoi nous étions a priori destiné·e·s et, en me documentant, je comprenais que ces débouchés que l’on nous proposait n’était pas sans conséquences, loin de là. J’ai compris qu’on n’allait pas résoudre des problèmes, mais passer notre temps à colmater des brèches que nous allions nous-mêmes créer. A l’inverse, des conférences (d’Arthur Keller, par exemple), des lectures politiques ou anthropologiques continuent de me faire me rendre compte qu’un autre futur est possible.
Pouvez-vous expliquer en détail ce qui vous a poussé à démissionner du cursus ingénieur CentraleSupélec et à exprimer vos préoccupations de manière publique?
J’ai décidé de démissionner après avoir longuement réfléchi sur ce que pouvait m’apporter le diplôme d’ingénieur CentraleSupélec, et si cela valait la peine de m’infliger des cours qui ne me plaisaient pas. En effet, j’aurais été capable, je pense, de terminer le cursus si je voyais un avantage concret au diplôme que je décrocherais, mais je n’en ai pas vraiment vu. Travailler dans un domaine qui me passionne, comme le théâtre ou l’enseignement ? Je peux le faire sans ce diplôme. Avoir un bon réseau ? Les deux années passées à CS m’ont comblé de belles rencontres et j’y ai déjà noué des liens avec de nombreuses personnes avec qui je pourrai, un jour peut-être, mener des projets. Obtenir un emploi en entreprise plus facilement ? Ça ne m’intéresse pas. Faire partie du cercle des honorables anciens de CentraleSupélec ? Ça ne m’intéresse pas non plus. Gagner beaucoup d’argent ? Non plus.
Certain·e·s me reprochent de laisser passer une chance de m’engager pour sauver la planète, mais je vois difficilement comment un ingénieur, aujourd’hui, peut utiliser sa fonction pour faire changer les choses, alors que sa fonction est de faire croître son entreprise en l’inscrivant dans une logique productiviste, ou alors de travailler pour un État complètement à côté de la plaque en matière d’écologie (on le voit en ce moment avec le projet A69 ou la pseudo « planification écologique » de notre gouvernement). Ou alors on parle d’ingénieur·e·s favorables à la décroissance ou qui font passer le bien commun avant l’intérêt privé, et ces ingénieur·e·s existent, mais sont bien sûr dans une remise en question permanente du système économique et politique tel qu’il est. Je salue et admire ces « ingénieur·e·s du futur », mais je me vois plutôt jouer un autre rôle, puisque chacun·e a un rôle à jouer dans le changement.
J’ai donc démissionné, et j’ai voulu que ma lettre soit ouverte pour exprimer, comme vous le dites très justement, mes préoccupations au plus grand nombre mais surtout pour envoyer un message de soutien à mes camarades. Lors de mes deux années d’école, j’ai pu constater que la ligne politique des écoles d’ingénieurs ne tenait pas compte sérieusement des objectifs que nous devrions avoir en matière d’écologie en général (climat, biodiversité, alimentation durable etc.) et cela m’a vivement inquiété. Ce qui m’a le plus frappé, c’est la place accordée au mensonge dans une formation prétendument scientifique : on accepte d’écouter des multinationales qui repeignent leur façade en vert à coup de discours scientifiquement faux ou simplement révoltants, et on laisse de la place à leurs « arguments », comme s’il était acceptable de promouvoir le statu quo auprès de futur·e·s dirigeant·e·s, quitte à désinformer pour poursuivre encore et toujours des intérêts privés. Je savais que beaucoup d’élèves étaient mal à l’aise par rapport à cette situation et sont plus ou moins désorienté·e·s car elles et ils ne savent pas comment participer au nécessaire changement de paradigme que nous devons accomplir. Je voulais donc envoyer un message de soutien à mes camarades : vous n’êtes pas seul·e·s à savoir que quelque chose ne va pas, on est plein à ne pas avoir LA solution, et on a envie d’en chercher une sans suivre le tapis rouge que l’école nous déroulera sous les pieds en sortie de cursus.
Vous parlez du manque d’intérêt pour les cours dispensés à l’école. Pourriez-vous donner des exemples spécifiques de ce qui vous a déçu dans le programme académique?
Comme je l’ai dit plus haut, j’adore les mathématiques. A CentraleSupélec, il y a des cours de mathématiques relativement exigeants, mais où on ne démontre quasiment rien (de nombreuses idées perdent ainsi de leur intérêt) et où l’on se concentre sur des champs des mathématiques qui ne m’enthousiasment pas particulièrement, par exemple les équations aux dérivées partielles. Il y aussi des cours de physique ou de sciences pour l’ingénieur qui m’intéressent assez peu et qui sont très généraux, et qui parfois ont le désavantage d’être donnés par des professeurs pas très intéressants. Enfin, il y a des cours qui ouvrent sur l’économie, la gestion ou d’autres matières moins scientifiques. Mais dans l’ensemble, les cours ne m’ont pas autant plu intellectuellement que n’a pu le faire la prépa, par exemple. C’est assez dommage, car il y a des bons cours, mais l’impression générale du début de l’année pour beaucoup d’étudiant·e·s est un désintérêt vis-à-vis des cours, ce qui ne les motive pas à être assidu·e·s. C’est pour cela que l’absentéisme explose après quelques mois et que beaucoup privilégient d’autres aspects de leur parcours comme l’associatif. Pour finir, je dirais que le gros désavantage se situe dans l’aspect un peu trop généraliste de l’école : on fait un peu de tout, donc on est obligé de se coltiner des cours qui ne nous plaisent pas pendant un certain temps, et les sujets sont abordés à la chaîne et pas vraiment en profondeur. Je ne nie pas qu’après plusieurs années à l’école on puisse arriver à s’accrocher et à créer une cohérence dans le choix de ses cours, mais le cursus étant très jeune et pas encore bien établi, beaucoup d’élèves se retrouvent dans une espèce de confusion généralisée.
Vous mentionnez que l’école vous a exposé à des entreprises que vous considérez comme “criminelles contre la vie sur Terre.” Pourriez-vous expliquer pourquoi vous avez cette perception et donner des exemples de ces entreprises?
Ce n’est pas vraiment une perception, c’est malheureusement un fait. Il y a des entreprises qui ont été créées pour exploiter des ressources sans limites et qui mettent toute leur énergie pour se trouver des excuses afin de continuer à exploiter et à ne pas écouter les scientifiques. Les personnes qui travaillent dans ces entreprises savent pertinemment depuis très longtemps qu’il est nécessaire de ne plus investir dans de nouveaux projets fossiles, de réduire le trafic aérien, d’arrêter d’artificialiser les sols, de sortir de l’agro-industrie pour aller vers une agriculture plus durable et d’arrêter de polluer les océans, entre autres. Il y en a d’autres qui font semblant de ne pas le savoir pour sauver leurs intérêts financiers ou leurs privilèges sociaux. Mais tout ce monde continue comme si de rien était, business as usual, et nous entraîne vers un futur où l’on continue à dépendre des énergies fossiles, où l’on ne respecte pas notre habitat, où l’on tue des vivants par milliards, et où l’on emmène (consciemment ou non) l’humanité entière sur la voie de l’effondrement. Bien sûr, l’État a son rôle à jouer en initiant des changements institutionnels, économiques et sociaux. Mais beaucoup de gens désespèrent – et je les comprends – de voir les acteurs économiques et les acteurs politiques marcher main dans la main droit vers le précipice, sous couvert de « croissance verte » et de tout un tas de bêtises. TotalÉnergies s’engage sans cesse sur de nouveaux projets fossiles, en brandissant ses micro-investissements en énergies renouvelables pour se donner le beau rôle, le tout en déplaçant des populations par milliers pour construire des pipelines et en désinformant massivement. C’est criminel. Safran s’engage à construire toujours plus d’avions, là encore en désinformant massivement sur l’impact d’un avion supposément « vert », qui n’existera jamais, ou en tout cas qui ne sera certainement pas une solution dans l’urgence climatique. C’est criminel. Les entreprises du bâtiment n’ont qu’un seul objectif : faire couler du béton, encore et toujours, en mettant en danger nos sols qui contiennent l’essentiel de la biomasse terrestre et qui sont essentiels pour notre alimentation. C’est criminel. Des cabinets de conseils (McKinsey, KPMG et consorts) aident ces entreprises à mettre la poussière sous le tapis et à continuer à exister. C’est de la complicité.
Quand on a connaissance de tout cela, on a envie de prendre le temps de se questionner ensemble. Ces entreprises ont comme ligne de mire, de facto, un futur où l’on dépend des énergies fossiles, où l’on dépend de la voiture et de l’avion, où l’on détruit massivement les écosystèmes pour s’y installer dans des gros immeubles et y manger tranquillement de la nourriture ultra transformée issue d’une agro-industrie qui n’a que faire du fonctionnement du vivant. C’est un futur qui, en plus d’être invivable, est très laid. Pourrait-il en être autrement ? Il n’est pas du tout impensable d’infléchir notre trajectoire, quitte à abandonner ces géants qui nous ont bien aidé – mais à quel prix ? – et qui datent d’un autre temps.
Ce qui me frappe et que je mentionne dans la lettre, c’est la position politique qu’a l’administration de l’école vis-à-vis de ces entreprises désuètes. Comme me disait un ami il y a peu : CentraleSupélec dit former les ingénieurs du futur, mais en réalité elle continue de former des ingénieurs du passé. Le futur, pour CentraleSupélec, ce serait d’intégrer des changements relativement mineurs à un système qui ne devrait surtout pas changer – le capitalisme industriel, pour ne pas le nommer. Je ne trouve pas cela très responsable, et même dangereux.
Et bien sûr, je n’ai parlé que de CS, mais on entend ce genre de discours dans de nombreuses grandes écoles : on peut citer l’X, Agro ParisTech ou encore HEC.
Vous appelez à la désertion et à l’exploration de nouvelles voies. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez par “nouvelles voies” et comment vous envisagez votre propre parcours après avoir quitté l’école?
Ce qui est à la fois déroutant et très enthousiasmant dans la situation où nous sommes, c’est qu’il est certain qu’il va falloir vivre autrement. Mais comment ? C’est ce que nous devons explorer. Il n’y a pas qu’une réponse possible, il y a plein d’expérimentations à mener, qui dépendent des personnes qui les mènent, des territoires, des problèmes abordés…
Pour ma part, je veux aller de temps en temps en immersion dans des exploitations agricoles en permaculture ou en agroécologie pour apprendre à mieux me nourrir, j’essaie d’explorer d’autres imaginaires avec mes lectures ethnologiques ou en utilisant l’art – je suis dans une formation de théâtre actuellement. Je suis aussi engagé politiquement : je participe à des mobilisations pour le vivant. Je précise que je ne suis encarté dans aucun parti. Mais je crois à l’émergence d’un rapport de force par la mobilisation citoyenne.
Quant à mon parcours, je suis donc dans une formation pour éventuellement travailler dans le milieu de l’art vivant (acteur, auteur ou metteur en scène) et je suis en fac de maths pour devenir prof de maths, afin d’avoir une sécurité dans un métier qui a du sens pour moi. Je continue d’être curieux de tout, cela m’aide à penser et agir dans ce monde.
Vous parlez de l’importance de préserver le vivant. Comment pensez-vous que les ingénieurs et les étudiants en ingénierie peuvent contribuer à cet objectif sans nécessairement suivre le chemin traditionnel des grandes entreprises?
Même si on ne suit pas le chemin des grandes entreprises, je pense cette question appelle une question sous-jacente : qu’est-ce qu’un·e ingénieur·e ? Aujourd’hui, l’ingénieur·e doit répondre à des problèmes le plus souvent sans questionner le problème lui-même. Autrement dit, sa fonction est complètement dépolitisée. Par exemple, un·e ingénieur·e qui veut travailler sur des autoroutes ne va pas forcément se poser la question de la nécessité de son action et des conséquences que cela peut avoir : à qui vont servir les nouvelles infrastructures construites ? Où vont-elles être construites ? Vont-elles détruire notre environnement ? Est-ce que cela va nous aider à consommer moins de matières premières ? Est-ce que cela va globalement nous faire tendre vers plus de résilience et d’autonomie, vers moins de dépendance aux énergies fossiles ? Etc.
En général, le système économique actuel conçoit l’innovation comme un processus qui crée un besoin plus qu’il n’y répond, et qui à cette fin va produire toujours plus pour créer toujours plus de bénéfice. Ce qui serait révolutionnaire, ce serait de pouvoir faire moins et utile. Le hic, c’est que pour qu’il y ait des investissements, il faut que cela puisse générer du profit, or ce n’est souvent pas le cas pour des innovations qu’on pourrait qualifier de « sobres ». En d’autres termes, devenir plus autonome et résilient en consommant moins, c’est pas bankable, ça ne crée pas de profit donc ça ne verra pas le jour sous le système actuel. Et c’est sans parler de l’effet rebond : si on crée des technologies plus économes (par exemple la 5G pour remplacer la 4G), leur utilisation massive et croissante va effacer les avantages qu’on aurait pu gagner en régulant notre usage. Les ingénieur·e·s d’aujourd’hui sont donc coincé·e·s dans ce système qui les dépasse mais auquel elles et ils participent activement, et qui peut les empêcher de créer des solutions vraiment utiles. C’est un des problèmes avec la fonction d’ingénieur aujourd’hui.
On pourrait aussi se référer à cette expression : quand on a la tête en forme de marteau, tous les problèmes semblent être des clous. Par exemple, on a un problème de changement climatique dû en grande partie aux émissions de gaz à effet de serre, la réponse de l’ingénieur d’aujourd’hui serait : créons des technologies pour essayer de régler ce problème. Mais c’est oublier que le problème de notre époque est systémique et non technique. Il y a de nombreux angles à aborder, et je pense que tant que la technique sera présentée comme neutre et que les ingénieur·e·s seront dépolitisé·e·s, on n’arrivera pas à apporter de réponse acceptable.
Préserver le vivant peut donc représenter un objectif pour un·e ingénieur·e, mais auquel il risque de chercher une mauvaise réponse car il ne s’est pas posé la bonne question. Il faudrait alors complètement remettre en question la place de l’ingénieur·e et, de manière générale, le système dans lequel ce métier joue un rôle. Peut-être qu’il existera toujours dans 50 ans un métier qui s’appellera « ingénieur·e », mais j’ose espérer qu’il sera complètement différent de celui d’aujourd’hui.
Vous évoquez également la nécessité de remettre en question les modèles éducatifs existants. Pouvez-vous expliquer comment vous envisagez une éducation qui prépare les individus à un monde plus durable et éthique?
Je suis en effet critique du modèle éducatif des écoles d’ingénieurs et de commerce : ce sont des établissements qui ont été créés à partir de la fin du 18e siècle pour servir une espèce de culte du progrès technique et de l’administration des humain·e·s, qui a pu être efficace pour augmenter le niveau de vie de certain·e·s, mais qui est aujourd’hui dans l’impasse.
On est donc en droit d’envisager une éducation qui suivrait un autre projet politique. Je ne suis pas expert en sciences de l’éducation, mais je crois que l’information sur les crises du vivant et la vie en société sont deux sujets cruciaux.
En outre, je ne sais pas si ceci pourrait faire partie d’un projet éducatif, mais nous avons un champ des possibles considérable à explorer et une myriade d’expériences politiques, scientifiques et sociales à mener, puisque nous devons découvrir de nouvelles manières d’accomplir des projets, de penser le monde et de faire société.
Comment espérez-vous que votre lettre et votre démarche inspirent d’autres étudiants ou professionnels de l’ingénierie à repenser leur rôle dans la société?
J’ai ressenti qu’une préoccupation majeure des étudiant·e·s qui m’entourent est la dissonance cognitive qu’elles et ils ressentent. D’une part, elles et ils engrangent des connaissances sur l’état désastreux de notre monde. D’autre part, elles et ils poursuivent des études, décrochent des stages, des emplois, tout en sachant que ça ne répond pas directement aux problèmes dont elles et ils sont au courant, et peuvent se sentir profondément désorienté·e·s. Cette lettre leur est en grande partie adressée, pour leur envoyer un message fort de soutien. J’ai reçu à mon tour bon nombre de messages qui m’ont fait chaud au cœur de personnes qui avaient besoin de lire les mots que j’ai écrits. J’espère que mon message permettra à toutes et tous de savoir qu’on n’est pas seul·e·s à vouloir construire autre chose, et qu’il participera de cette parole que l’on entend de plus en plus et qui peut fédérer et exhorter à l’action.
Pouvez-vous partager votre point de vue sur la responsabilité des établissements éducatifs comme CentraleSupélec dans la formation des futurs ingénieurs et leur impact sur la société?
Je pense avoir déjà répondu sur ce que je pensais de « l’impact » des ingénieur·e·s sur la société. Je pense que les grandes écoles font partie intégrante d’un système capitaliste et industriel qui a fait son temps. Si responsabilité il y a, c’est dans la sempiternelle perpétuation d’un système dont on sait qu’il ne fonctionne plus. Bien que certains aspects de la formation semblent intégrer des morceaux choisis d’écologie, je pense que notre société ne sera pas complètement responsable tant que les grandes écoles, qui cristallisent un élitisme et un techno-solutionnisme d’un autre temps, continueront d’exister. Leur raison d’être originelle n’est plus pertinente, et elles ne semblent pas prêtes à la renier, à passer à quelque chose de radicalement différent. Elles sont au service d’industries qui n’ont pas intérêt à changer, je n’ai donc pas d’espoir qu’elles changent.
Comment envisagez-vous la coexistence entre les besoins économiques actuels et la nécessité de préserver l’environnement et de promouvoir un monde plus juste?
Ce que nous appelons « besoins économiques actuels » sont des besoins entièrement dépendants d’un système politique qui a créé des exigences propres au capitalisme. De très nombreuses civilisations, que la nôtre a préféré massacrer, n’ont jamais connu les « besoins économiques » dont nous parlons ici. Notre économie est une construction qui relèverait, à mon avis, d’une particularité ethnologique. La prétendue « science économique » étudie un domaine qui n’a rien d’anodin. L’économie est montée de toutes pièces et s’est imposée à nous pour devenir la clé de voûte de notre rapport au monde : il y aurait une fracture entre l’humain et la nature, et l’humain dispose de la nature tantôt comme zone à protéger, tantôt comme ressource à exploiter, toujours comme relevant d’un concept qui lui serait totalement extérieur. Cette vision du monde très particulière persiste depuis plus de 150 ans, ce qui exceptionnellement long, trop long.
J’évoque tout cela pour pouvoir répondre en une phrase à votre question : nos « besoins économiques » ne sont que le reflet d’une civilisation qui ne demande qu’à être changée, et si nous partons de valeurs d’écologie et de justice sociale, alors nous pourrons envisager un monde plus viable.
Pour étayer mes propos sur l’anomalie de notre longue civilisation fondée sur l’économie, je ne peux que recommander un excellent livre : « Ethnographies des mondes à venir », par Philippe Descola et Alessandro Pignocchi.
Pouvez-vous donner des conseils ou des recommandations aux étudiants en ingénierie qui pourraient partager certaines de vos préoccupations et envisager des actions similaires?
Je ne sais pas si j’ai des conseils, mais plutôt un message à faire passer. Si vous sentez que quelque chose ne va pas dans ce que vous faites, c’est normal, vous n’êtes pas seul·e·s. Effectivement, quelque chose ne va pas. Mais ce n’est pas une fatalité. C’est une chance, si on veut. Ne restez pas seul·e·s avec vos questionnements, rencontrez d’autres personnes, lisez, faites des choses. Ne cédez pas au mensonge. Il y a plein d’initiatives à explorer, de personnes à rencontrer dans les milieux militants, dans les exploitations suivant l’agroécologie, dans les associations… C’est un chemin qui paraît difficile, mais je pense que cela fait davantage de bien d’être en accord avec soi-même, ou au moins d’essayer, que de se sentir irrémédiablement bloqué.